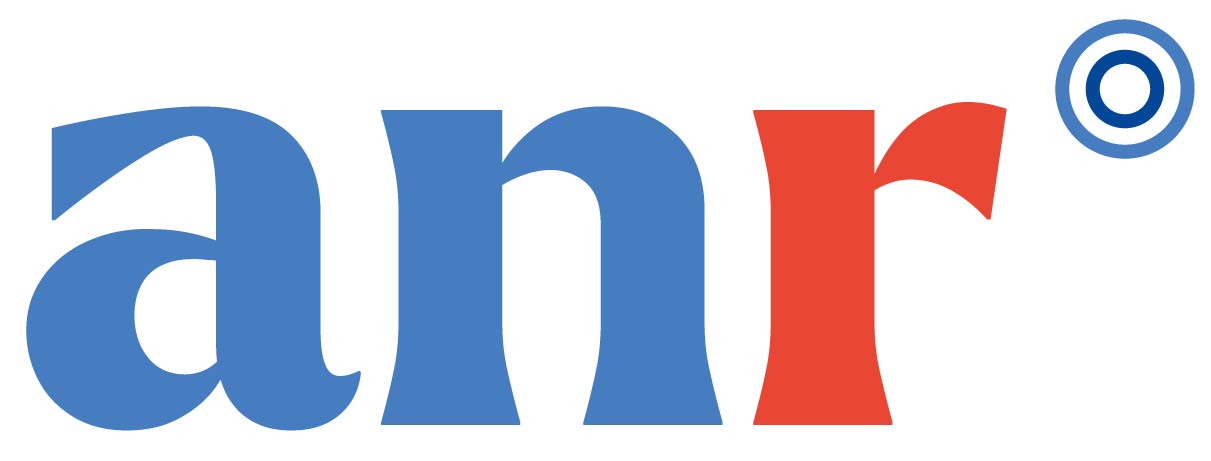Les informations recueillies vont faire l’objet d’un traitement scientifique, sous la responsabilité du directeur de l’unité de recherche Bordeaux Sciences Economiques, située à Pessac (33) – 16 avenue Léon Duguit. Le traitement est réalisé dans le cadre du projet A-MAP « La précarité Alimentaire en France : Mesures, Analyses et Politiques » coordonné par M. Antoine BERNARD DE RAYMOND, Directeur de recherche INRAE à Bordeaux Sciences Economiques (BSE). Ce projet est financé par l’Agence Nationale de la Recherche pour une durée de 3 ans.
Finalités du projet
Ce projet de recherche a pour objectif d’étudier la précarité alimentaire. Ce phénomène est peu étudié et mal connu dans les pays riches comme la France. Le projet fait notamment l’hypothèse que la précarité alimentaire touche non seulement les groupes vulnérables, mais aussi les personnes ayant un emploi et des revenus réguliers. Le projet comporte deux tâches de recherche : (1) étude de la prévalence de la précarité alimentaire dans la population française, (2) étude de dispositifs innovants de lutte contre la précarité alimentaire.
L’étude basée sur des enquêtes quantitatives (questionnaires) et qualitatives (entretiens, observations) permettra d’objectiver les mécanismes conduisant à la précarité alimentaire, ainsi que les stratégies d’ajustement des ménages.
Les enquêtes seront menées auprès d’individus et ménages, en comparant des territoires variés, tant au niveau de l’offre alimentaire que des dispositifs de lutte contre la précarité alimentaire (Gironde, Hérault et Seine Saint-Denis).
Base légale du traitement
La base légale du traitement repose sur l’exécution d’une mission de recherche publique.
Participation libre
La participation au projet A-MAP « La précarité Alimentaire en France : Mesures, Analyses et Politiques » est entièrement libre et volontaire.
Confidentialité des données recueillies
Le projet A-MAP « La précarité Alimentaire en France : Mesures, Analyses et Politiques » prend les engagements suivants :
- Les données sont traitées uniquement à des fins de connaissance scientifique et de compréhension des problématiques abordées dans le projet
- L’identité des personnes enquêtées sera protégée à l’aide d’un pseudonyme dans tous les écrits produits sur la base des entretiens (comptes rendus d’entretien, notes d’analyse échangées entre les chercheurs, publications …)
- Seul le responsable du projet détient la table de correspondance qui permet de faire le lien entre l’identité de l’interviewé et le pseudonyme attribué dans les écrits produits.
Destinataires des données personnelles
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : les membres du projet chargés du traitement des données. Ils seront chargés de pseudo-anonymiser les données avant de les mettre à disposition aux membres du projet sur des outils sécurisés.
Durée de conservation
Les données personnelles sont conservées durant les phases de passation des enquêtes (questionnaires et entretiens) dans l’attente de leur pseudo-anonymisation.
- Les enregistrements audios seront supprimés dès que la transcription texte aura été effectuée.
- La table de correspondance permettant de faire le lien entre l’identité de l’interviewé et son pseudonyme sera effacée 4 ans après les dernières publications.
Seule la version anonymisée du corpus pourra faire l’objet d’un réemploi dans le cadre d’un projet de recherche ayant la même finalité.
Mesure de sécurité
Les mesures sont prises pour garantir la confidentialité et la qualité des données personnelles tout au long de leur cycle de vie, plusieurs dispositions sont mises en place :
- Pseudo-nymisation des données
- Stockage et hébergement des données du projet sur les services sécurisés de l’infra-structure de recherche Huma-Num
- Utilisation exclusive des messageries institutionnelles pour les échanges d’information
- Réalisation d’un Plan de gestion des Données pendant le projet
- Inscription des traitements de données personnelles propres à ce projet dans le registre des activités de traitement du CNRS
Diffusion
Les résultats de cette recherche seront diffusés de façon anonyme dans des colloques scientifiques, dans des rapports destinés aux financeurs et dans des revues académiques.